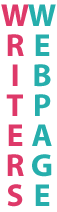L'Homme qui n'avait besoin de rien
Extrait du roman
Traduit par Paulius Stasiūnas
Cette histoire s’est déroulée à maintes reprises,
mais sa fin fut toujours la même
POINT
Moi
En bas
Non, non, non. Je n’ai absolument pas le droit de me comporter de la sorte.
Il est trois heures, je suis étendu sur mon tapis, je ne bouge pas. Je sais que ce n’est pas bien de ne pas bouger, il faut marcher. Mais je ne peux pas marcher, puisque je suis en position horizontale. Je savais marcher allongé quand j’étais petit, maintenant je ne sais plus. Or ça devrait être le contraire. Il y a beaucoup de choses qui devraient être leur propre contraire, mais elles ne le sont pas. Du coup, je regarde par la fenêtre. La fenêtre est si sale qu’elle me fait pitié. Je regrette de ne pas l’avoir nettoyée alors que je pouvais encore marcher.
Vous savez ce qu’elle a fait ? Vous ne le devinerez jamais.
Je ne peux plus supporter cette fenêtre crasseuse, alors je me lève et je la nettoie. Ça me prend longtemps. Je ne comprends pas comment des objets verticaux que personne ne touche jamais peuvent s’encrasser autant.
Je finis de la nettoyer et m’allonge à nouveau. Je reste étendu sans réussir à bouger.
Je n’ai plus de bras, ni de jambes. Ou peut-être y a-t-il des membres, mais ce ne sont pas les miens, étant donné que je ne parviens à bouger aucun d’entre eux. Je n’ai plus que ma tête et mon dos. J’en suis sûr et certain, parce que cela fait déjà un bon moment que je suis vautré là, mon dos est endolori, et ma tête pense. J’ai aussi des lèvres, que je mouille de temps en temps avec ma langue. Pas parce qu’elles sèchent. Je cherche seulement à m’assurer qu’elles sont toujours là. J’ai lu l’histoire d’un homme qui n’en avait pas, de lèvres. Il était simplement né ainsi. Selon ses propres dires, il avait passé toute sa vie à être malheureux. Cela ne m’étonne aucunement, c’est vraiment important d’avoir des lèvres. Si vous me prenez mes lèvres, alors prenez moi tout entier. Je ne veux pas être divisé.
Pourtant elle, elle m’a divisé. Elle m’a divisé en celui que j’étais avant, et en celui que je suis devenu dès que je l’ai aperçue.
Elle se tenait devant la porte, toute ébouriffée. Je dis « pardon » et j’essayai de passer, et elle me demanda pourquoi je m’excusais, peut-être pressentais-je que j’allais lui faire du mal. Et elle ne bougea pas d’un centimètre. Alors je l’ai tout simplement poussée. Elle ne s’en est pas étonnée le moins du monde, elle m’a simplement demandé si c’était là ce pourquoi que je lui avais demandé pardon.
Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle m’a obligé à tomber amoureux d’elle.
Lorsque je la vis pour la première fois, elle me parut dégueulasse. Belle, très belle même, mais absolument pas telle que je l’aurais voulue. Sa peau très mate, d’un bleu-marron. La moitié de ses cheveux teinte en blanc, quelle connerie. L’un de ses yeux était plus foncé que l’autre, quoique même le plus clair des deux tirât vers le marron. Je n’avais jamais possédé de fille aux yeux marron. Impossible de comprendre ce qui se trame dans leur tête, elles te braquent juste de leurs crevasses charbonneuses, comme si elles voulaient te voler, happer quelque partie de toi par ces abîmes circulaires, ou au contraire, t’embourber à travers eux de quelque chose dont personne ne veut. Je n’ai jamais apprécié les personnes qui me faisaient quelque chose sans m’en avoir demandé la permission au préalable, et peu importe s’il s’agit de donner ou de prendre.
De plus, elle souriait constamment. Je l’ai poussée, et elle, elle continuait de sourire, comme si je venais de faire précisément ce qu’elle attendait de moi.
Bref, je la trouvai dégueulasse. C’est pourquoi je la bousculai et passai mon chemin.
Il ne s’est rien passé, je ne fus pas foudroyé, ni hypnotisé. Je me souvins juste que j’avais laissé mes clés de voiture dans ma chambre. Ce qui signifiait que je devrais retourner les chercher. Evidemment, elle se tenait à nouveau devant la porte. Je ne sais pas ce qu’elle avait fait durant les quelques secondes où j’avais eu le dos tourné, mais elle semblait encore plus ébouriffée qu’avant. En plus, elle fumait. Ses lèvres pulpeuses, ses doigts longs, et ses mains bien trop élégantes. Je me dis que si elle m’embrassait, sans doute en mourrais-je sur le coup.
Lorsque je m’approchai, elle dit « pardon », je ne compris pas pour quoi. Sans doute avait-elle pris conscience qu’elle pouvait me tuer d’un simple baiser. Mais elle ne l’aurait probablement pas fait, parce qu’elle n’aurait pas voulu devoir jeter sa clope.
Son cou était si long, il semblait doux, si je le touchais j’en mourrais là. Je me promis de ne jamais le faire.
Elle avait attaché autour de lui, va savoir pourquoi, une multitude de chaînettes ornées de boules de cristal de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Ou peut-être n’était-ce pas du cristal, je n’en sais rien. Et puis peu importe, de toute façon son corps faisait toutes ces boules sembler plus foncées qu’elles ne l’étaient réellement. J’en attrapai une avec mes doigts pour l’examiner. Éloigné d’elle, le cristal devint écarlate, translucide, comme s’il avait perdu son appui. Je n’aimais pas les objets qui semblaient dénués de substance, alors je lâchai la petite boule. Elle était si lourde qu’elle résonna en percutant son torse.
Je ne comprenais pas pourquoi elle ressentait le besoin de s’affubler de ces bouts de verre. Aucun doute : elle sait que c’est elle qui leur insuffle la vie, que sans elle ils ne sont rien. Mais on ne peut pas constamment se trimballer avec tout ce qui serait sans nous dénué de tout son sens. Je me dis qu’elle devait sans doute être quelqu’un de très bien, puisqu’elle m’avait aussi donné un sens à moi, et ce sans aucune résistance. Elle avait fait de moi un autre de ses cristaux artificiels, qui séparés d’elle se ternissent, deviennent translucides et absolument inutiles.
J’ai dû rester planté devant elle pendant un bon moment, puisqu’elle eut le temps de finir une cigarette et d’en allumer une autre. Ensuite elle s’approcha de moi et me poussa. Ce fut si inespéré que je faillis trébucher.
« 1 : 1 », dit-elle. Et elle entra.
Je fus pris d’une envie incommensurable de refaire pencher le score de mon côté. De me venger, de montrer qui était le plus fort. Et de la toucher. De l’obliger à me toucher à nouveau. Mais elle disparut, sans que je sois capable de comprendre où. J’essayai de la chercher, même si je me disais que je ne faisais que flâner, sans aucun but concret. Que je sache, il n’est pas interdit de flâner. Chercher non plus. Je ne sais pas s’il n’est pas interdit de trouver.
*
Je l’aperçus pour la deuxième fois un jour parfaitement ordinaire, environ six mois plus tard. Il faisait encore nuit quand je me réveillai. Je ne voyais pas où je mettais les pieds, je marchai sur quelque chose et j’écrabouillai ce quelque chose. Sans regret, ça lui apprendra à traîner là où il ne faut pas.
Je mens, en vérité je regrettais, et beaucoup. Je m’en voulais. J’avais toujours piétiné tout le monde, et je m’en haïssais. Je haïssais le fait que je me considérais meilleur que les autres, plus important, plus digne d’amour et de reconnaissance.
J’avais piétiné mon frère. Ce n’était pas mon vrai frère. Ma mère s’était trouvé un nouvel homme lorsque j’avais cinq ans. Ma mère était très belle, même si l’une de ses jambes était plus courte que l’autre : cela ne la gênait absolument pas, au contraire, cela lui conférait une sensualité toute particulière. Je n’avais jamais aimé ma mère et j’avais toujours eu honte d’elle. Et même si je l’aimais beaucoup, j’étais forcé de constater que non seulement elle couchait avec tous les hommes qui passaient (même si cela ne me regarde pas), mais qu’en plus elle était complétement idiote.
Je ne sais pas pourquoi Dieu avait décidé de ne rien lui accorder : ni beauté, ni intelligence. En grandissant, je découvris la théorie de la compensation. Mais même là, je ne parvenais toujours pas à voir ce que Dieu lui avait donné afin de compenser ce dont elle manquait. Ma mère disait que c’était moi, sa compensation. Je ne pense vraiment pas que je vaux grand-chose. Donc cette tendance que ma mère avait à me déifier constituait pour moi une preuve de plus de sa bêtise. J’avais toujours refusé d’être comme elle, mais malheureusement je l’étais. Tout aussi laid, et en plus je couchais avec toutes les femmes qui passaient. Tout comme elle, je n’arrivais pas à prononcer le son « r » correctement, mes oreilles étaient asymétriques et le pouce de ma main droite était tordu.
Lorsque j’avais cinq ans, Dieu décida de donner à ma mère une nouvelle bénédiction : il lui envoya un homme tout maigrichon et qui n’arrêtait jamais de suer, mais qui était très économe et savait écrire des poèmes. Il était tout aussi bête que ma mère, même s’il s’orientait bien mieux dans le monde. Son homme se mit à répéter sans cesse qu’un prix Nobel lui serait attribué sans l’ombre d’un doute, soit cette année, soit l’année d’après. Mais l’année d’après il contracta la tuberculose, personne ne comprit jamais comment, peut-être par ses bouquins. J’ai lu quelque part que les pages des livres sont parfois empoisonnées, volontairement ou involontairement. Il ne tarda alors pas à mourir, et là Dieu décida de bénir ma mère pour la troisième fois : il lui envoya mon frère.
Mon frère était tout aussi maigre et suait tout autant que son géniteur dès sa naissance. Cela m’agaçait, car je m’en retrouvais obligé à songer qui avait hérité de quoi, et de qui. Ce n’est qu’alors que je compris que je n’avais jamais eu de père. Les généticiens exposaient leurs théories comme de concert, chacune toujours plus identique à la précédente, et moi, je ne rentrais dans aucune d’entre elles. Mon père, je n’en avais hérité absolument rien. Ni la virilité, ni l’envie de plaire aux femmes, ni le courage, ni l’amour-propre. Rien. C’est pourquoi j’avais toujours été le même : pareil, uniforme, simple et aimé de tous.
Mon frère était à mes antipodes. Même arrivé à l’âge adulte, il ne cessa jamais d’être un sempiternel dilemme pour les autres aussi bien que pour lui-même, des doutes sans relâche, des extrêmes à n’en plus finir, des attaques maniacodépressives incessantes. J’en ai toujours été jaloux. Il arriva un moment où je n’en pouvais plus de mener une existence normale, je n’avais plus ni le temps ni l’énergie pour quoi que ce soit d’autre. Alors j’ai piétiné mon frère. Ce ne fut pas difficile. Lorsqu’il passa de sa phase d’agoraphobie à sa phase claustrophobe, je m’arrangeai pour qu’il reste coincé dans l’ascenseur. Et ça a marché.
J’avais tout minutieusement planifié, il était midi, une heure où il n’y a pas un chat dans l’immeuble. Il est resté enfermé dans l’ascenseur deux heures environ, il s’est fait des griffures partout et il s’est presque étouffé. Mais il s’en est remis. Ses extrêmes sont à jamais restés enfermés dans cet ascenseur, même après qu’on se soit tant bien que mal débrouillé pour l’en tirer. Il fallut user de force, parce qu’il se cabra et refusa de sortir de bon gré. Les ouvriers ne montrèrent aucun état d’âme, ils réparèrent simplement l’ascenseur et s’en allèrent. Personne ne veut faire le travail de quelqu’un d’autre. Et ne venez pas me dire que c’est à cause des temps où nous vivons. Il n’en a jamais été autrement.
Ce sont les voisins qui ont dégagé mon frère de l’ascenseur. Ils l’on tout simplement tabassé et l’en ont jeté à coups de pied. C’est à eux que ma mère en tint rigueur jusqu’à la fin de ses jours. Cela m’agaçait. Je pense que vous pouvez très bien comprendre pourquoi, chacun veut recueillir le fruit de son labour lui-même. Mais l’amour maternel est ainsi fait. Il n’a que faire des actions de ses progénitures, que les enfants accomplissent des prouesses inimaginables ou qu’ils restent les pires des salauds, leurs génitrices les aimeront tout autant. Voilà une raison de plus pourquoi les enfants haïssent leurs mères.
Mon frère s’est donc rétabli, il est devenu gris et uniforme, alors six mois plus tard tout le monde l’avait déjà oublié. Il n’y a là rien d’étonnant, la platitude n’impressionne pas. Je n’ai jamais vu personne aller admirer une plaine, tout le monde s’acharne, comme par un complot, à partir en montagne, comme pour prouver qu’un terrain accidenté est une qualité en soi. Si l’on se met à plusieurs pour prouver quelque chose, tout le monde y croira, peu importe ce que c’est.
*
Me souvenir de cette histoire avec mon frère m’énerva, alors je ne cherchai même pas à savoir ce qu’était que je venais d’écrabouiller cette fois-ci. Je soulevai un coin du paillasson et me servis de mon pied pour pousser ce « quelque chose » en dessous. Je me fis un café, j’oubliai d’y ajouter du lait et me brûlai les lèvres.
Parfois je travaille ailleurs, alors je dois prendre l’avion. J’ai très peur. J’ai vu beaucoup de films se déroulant dans un avion, où une femme d’une beauté surréelle s’assoit à côté d’un homme, ils discutent, l’homme a l’air heureux. Le pire, c’est qu’une fois sortis de l’avion ils ne terminent jamais leur histoire, ils vont quelque part, ils font quelque chose, et la plus part du temps ça finit mal. C’est précisément de cela que j’ai peur, alors en avion j’essaie de faire en sorte de m’asseoir à côté d’un homme ou d’une femme laide. Et quand bien même je devais, une fois l’avion atterri, l’emmener quelque part, ce serait bien plus facile que d’y emmener une belle femme.
Je n’aime pas la beauté en général. Tout le monde dit que je suis beau. Mais je n’aime pas cela du tout. Et j’aime encore moins lorsque c’est la beauté de mes mains, de mes oreilles, ou autre que l’on complimente, car cela commence à me diviser.
Je ne ratai pas l’avion, j’arrivai pile à l’heure. La plupart des places étant déjà prises, je m’installai aux côtés d’une femme obèse avec un enfant. Evidemment, à l’atterrissage l’enfant pleurera. (Ce n’est pas parce que je suis capable de prédire l’avenir que je le sais. C’est tout simplement toujours le cas.) Mais il serait naïf de s’attendre à des conditions idéales dans un espace public.
Je me bouchai les oreilles de mes écouteurs, mis le volume au maximum et fermai les yeux. J’aime m’endormir avec une musique au son très fort, ça m’oblige à consciemment me bloquer pour ne plus l’entendre.
Lorsque les gigotements de la dame à l’enfant s’intensifièrent au point de me devenir insupportables, j’ouvris les yeux. Je crus rêver. La dame à l’enfant ramassait ses affaires, Elle se tenait debout à côté de moi, et l’hôtesse expliquait aimablement qu’il y avait eu une erreur, que les enfants ne peuvent pas être assis à une issue de secours, et qu’elle devait par conséquent les changer de place.
Je continuai mon rêve en toute sérénité. Pourquoi m’inquiéter, si ce n’est qu’un rêve ?
Elle annonça d’emblée qu’elle s’appelait Sylvie. Ce nom lui allait bien, même s’il était vraiment loin d’être beau.
« Ah, quel joli nom ! », lui dis-je aimablement. Ma mère m’avait enseigné qu’il fallait être poli.
Je ne sais pas si ce qui vaut pour la réalité vaut aussi pour les rêves, mais dans le doute je m’efforçai à paraître le plus normal possible. A mon avis, il ne faut jamais négliger de prendre toutes ses précautions, même pas en rêve.
Elle portait autour du cou les mêmes colliers. Tant pis.
« Tu as de beaux yeux », dit Sylvie. Elle me déçut complétement. Je me sentis comme un fragment d’un animal empaillé, comme la tête sciée une biche préparée dans les règles de l’art et accrochée au mur afin de pouvoir y être admirée de tous. On dit alors : « Comme ils sont beaux, les yeux de la biche. » On ne peut pas parler d’yeux. Beaucoup refusent de faire don de leurs yeux et de leur cœur après leur mort. Pour les poumons et le foie – servez-vous, mais ne touchez surtout pas à mes yeux. Les yeux, c’est le reflet de l’âme. Et s’il en est ainsi, alors les âmes des biches sont scintillantes. Elles semblent joviales et heureuses, même si j’ai du mal à croire qu’elles aient vraiment de quoi se réjouir. On ne peut pas se réjouir s’il y a quelque chose qui nous manque, surtout si ce qui nous manque, en l’occurrence, c’est le reste de notre corps.
Je ne sais pas, le reste de leur corps est peut-être là, derrière le mur, dans la pièce d’à côté. Je ne peux pas vérifier. Quand j’entre dans l’autre pièce pour voir s’il y est, il n’y est pas, mais cela ne signifie pas qu’il n’y est pas non plus lorsque j’en sors. Mais peu importe. L’essentiel, ce sont les yeux.
Toute cette situation avait créé en moi un certain élan romantique, alors je lui demandai :
« Ça te dirait que je te récite un poème ? »
Elle ne répondit rien, pas un seul muscle de son visage ne se mut. Elle ne croyait sans doute pas que j’étais sérieux. Elle ne me connaît pas encore, mais elle sait déjà tout de moi. Comment fait-elle ?
« J’y vais.. ? », redemandai-je, juste pour être sûr.
« Vas-y », répondit-elle plutôt ironiquement. Dommage, le poème que j’avais préparé était plutôt pas mal. Mais le bruit du moteur était très fort, il fallait crier, ce qui ne correspondait pas vraiment à son ambiance. Mais comme je l’ai déjà dit, il serait naïf de s’attendre à des conditions idéales dans un espace public.
« Il lui faut garder le corps, le cou et la tête bien droits, le regard fixé sur l’extrémité du nez. »[*]
Sylvie ricana (peut-être comprenez-vous ce qu’il y a là drôle, parce que moi, je n’en ai pas la moindre idée), et me demanda :
« C’est de toi ? »
« Ce poème est de moi. Mais il a été réimprimé par les Hindous. »
Sylvie continuait à sourire. Alors je lui dis :
« Tu ne me crois pas ? Tu devrais. Il faut croire en ce qu’on nous dit. »
« Ma grand-mère est morte lorsqu’elle avait quatre-vingt-dix-neuf ans. Un an avant sa mort, elle s’est mise à chanter. Presqu’aussi bien que Pavarotti. Personne ne comprenait ce qui s’était passé, car elle n’avait jusque là eu ni voix, ni ouïe. On l’a emmenée voir toutes sortes de médecins, mais aucun d’entre eux n’est parvenu à trouver quelque maladie que ce soit. Et puis elle est morte ainsi, en chantant, ou peut-être à force de chanter, parce que personne n’a jamais réussi à déterminer aucune autre raison.
Je trouvai son histoire vraiment intéressante, mais je ne compris pas tout à fait le rapport avec mon poème. Sans doute son cou se bloquait-il à force de chanter, et ne put-elle plus jamais tourner la tête malgré tous ses efforts. De toute l’année.
Je ne me souviens jamais avoir été pris d’une une si forte envie de toucher quelqu’un. Mais j’avais peur qu’en la touchant mon cœur n’explose, ou qu’il ne se produise une catastrophe encore plus grande, que l’avion ne s’écrase, par exemple. Il ne serait pas bon que d’autres meurent à cause de mes désirs, alors je restai assis sans toucher à quoi que ce soit.
*
J’étais tombé amoureux, et alors ? Ce n’était pas la première fois. Lorsque ce n’est pas la première fois que l’on tombe amoureux, on sait à quoi s’attendre, car les amours ne diffèrent pas les uns des autres.
Le hublot était couvert de givre, opaque. Cela m’agaçait. Les hublots doivent être transparents.
« Tu vois quelque chose ? », demanda Sylvie.
« Non », rétorquai-je méchamment, comme si c’était de sa faute.
Au cas où, je lui demandai :
« Tu n’es pas leucémique ? »
« Encore une question, et je demande à l’hôtesse de me changer de place. »
Je ne sais pas pourquoi elle s’était irritée. Je ne lui avais demandé cela que pour m’assurer que ce ne serait pas une histoire d’amour banale, comme dans les films, où l’un des personnages meurt, où l’autre ne pleure quasiment pas, et où ce n’est que le public qui pleure. Je pense que le public n’a pas de raison de pleurer.
Sylvie faisait semblant de lire un livre. Je sais qu’elle faisait semblant, parce qu’elle ne tournait pas les pages. Je me penchai légèrement vers elle, car je voulais voir ce qui y était écrit. Il n’y avait pas de texte, seulement la photo d’un château.
Le plus souvent, les gens construisent des châteaux :
- de sable ;
- de neige ;
- d’air.
Je ne sais pas lesquels d’entre eux tiennent le plus longtemps. Mais ce ne sont pas forcément ceux qui tiennent le plus longtemps qui sont les plus beaux. Et celui-ci était beau. Il était fait de billes en plastique de toutes les couleurs. Toutes petites en bas, de plus en plus grandes vers le haut. A la place des tours il y avait simplement de grosses boules.
« J’aimerais bien vivre dans un château comme celui-ci », dis-je à Sylvie.
« Il n’y manquerait plus que toi ! », pouffa-t-elle.
Je me plaisais à l’idée que son château tomberait en ruine si j’y entrais, que les billes m’en dégringoleraient dessus lentement et longtemps. Je n’aime pas les choses éternelles. Tout ce qui est éternel est ennuyeux. Les femmes qui me disent : « je t’aimerai pour l’éternité », je les quitte à l’instant même. Sans leur expliquer quoi que ce soit, je me lève et je m’en vais, tout simplement. Je m’arrête à la porte et me retourne afin de les regarder une dernière fois. J’ai vu cette scène dans un film, elle m’avait semblé très belle, alors maintenant je fais pareil.
Je répands la beauté.
*
Je m’habille souvent en gris. Je pense que le gris met l’homme en valeur. On ressemble alors à une pierre, or tout le monde aime les pierres.
Je ne mange rien. C’est précisément pour cette raison que je grossis. Vous avez sans doute aussi dû remarquer que le « rien » grandit vite.
Je ne suis pas satisfait de mon apparence. Même les jours où je me trouve beau, je sais que ce n’est qu’une illusion d’optique, un mirage qui se dissipera aussitôt que l’éclairage aura changé.
Je n’avoue jamais à personne que je ne suis pas content de mon apparence. Je ne veux pas non plus que cela se remarque. Ce serait trop, même pour moi.
Pour avoir l’air plus expressif, je me noue une écharpe grise autour du cou. Ne me demandez pas si je le fais aussi durant l’été. Ne me demandez rien. De toute façon, soit je ne vous répondrai pas, soit je vous mentirai. Les gens qui aiment mentir me plaisent. Mentir non pas par intérêt, mais juste pour le plaisir, aussi bien le sien propre, que celui des autres. Il n’y a pas de vérité, et je n’aime que ceux qui comprennent cela et qui ne s’en font pas d’états d’âme. Pourquoi s’en faire de quelque chose que l’on ne peut pas changer ? Autant y prendre du plaisir.
Avant, j’avais des cheveux longs. Mais la fille avec qui j’avais passé cette nuit-là me les a coupés. Je dormais et je n’ai rien senti. Le matin elle me dit que j’étais bien plus beau. Je ne compris pas tout de suite pourquoi. A cause de l’amour, pensai-je. J’ai continué à penser la même chose même quelques jours plus tard, après m’être vu dans la glace (parce que beau, je ne l’étais vraiment pas).
Je ne me rendis compte que mes cheveux avaient été coupés que la semaine suivante, parce que je ne possède pas de miroir. Si j’en avais un, j’y verrais toujours la même chose, et ça ne me plairait pas : des cernes bleuâtres, de la poussière et un cœur brisé. Je ne sais pas si vous voyez votre cœur dans le miroir, mais moi oui. Il est très semblable à ceux que l’on trouve sur les cartes postales, mais la déchirure au milieu est bien plus profonde, il est presque scindé en deux. Ses deux parties ne tiennent ensemble que par un tout petit filament, sans doute un vaisseau sanguin, mais je ne sais pas s’il s’agit d’une veine ou d’une artère.
J’ai demandé à ma mère si mon cœur avait toujours été ainsi. A mon avis, si les mères existent, c’est justement pour répondre à ce genre de questions. Je n’ai besoin de mère pour strictement rien d’autre. Dommage que je ne me souvienne pas de sa réponse.
Lorsque je me vis dans la glace cette fois-là (dans les toilettes du Macdo, où je fixe le miroir à chaque fois que je me lave les mains, car il n’y a rien d’autre à regarder), je ne prêtai aucune attention à mon cœur, car mon regard fut obnubilé par mes cheveux. Ils étaient beaucoup plus longs d’un côté que de l’autre.
« C’est de ta faute, – dit la fille lorsque je la rencontrai la fois suivante. L’autre côté de ta tête était contre l’oreiller, je n’y peux rien. » J’étais d’accord avec elle. Tout ce qui arrive aux gens n’est jamais que de leur propre faute.
Elle s’appelait Ana, ou peut-être Anna, je ne me souviens pas vraiment. Mais je pense que ce ne pouvait certainement pas être Annna. La seconde fois je l’avais rencontrée par hasard. Le plus souvent j’évite de revoir les filles une seconde fois (quoique cette fois-ci j’avais tort, la deuxième nuit fut bien meilleure que la première). La première fois je l’avais aussi rencontrée par hasard. Elle était debout sur le parking des vélos. Lorsque je lui demandai ce qu’elle faisait là (je ne le lui demandai que parce que je voulais, elle n’était pas belle, donc il n’y avait vraiment aucune intention cachée), elle me répondit :
« Je loue des vélos ».
Je me dis que j’avais besoin d’un vélo, alors je la payai, et assez cher. Alors elle dit :
« Choisis le vélo que tu veux. »
Il y en avait beaucoup, ils étaient organisés en de belles rangées, quoique peut-être un peu trop proches les uns des autres. Je choisis le plus beau, noué d’un bandeau blanc au milieu. Alors elle me dit :
« Tu peux le prendre ».
Malheureusement le vélo était cadenassé, tout comme tous les autres vélos du parking.
Elle rétorqua qu’elle ne louait que les vélos, pas leurs clés. Je m’assurai une fois de plus de la clémence du destin à mon égard, car de quoi aurais-je eu l’air sur un vélo pareil ?
Une musique irritante venait de je-ne-sais-où, sûrement du Bach. Ou peut-être pas, mais je n’étais pas vraiment calé en matière de compositeurs (évidemment, je connaissais aussi Tchaïkovski, mais il ne s’agissait certainement pas du chant du cygne mourant, j’en mettrais ma main à couper). C’est pourquoi Bach était ma seule option.
« Ce n’est sans doute pas du Bach, il n’aurait jamais pu écrire une chanson pareille », dis-je, et m’en réprimandai fortement dans ma tête. Si tu dis quelque chose, dis le fermement. Pourquoi hésiter à tout bout de champ ? Les femmes n’aiment pas les indécis. Un homme doit resplendir de force et d’assurance.
Moi, je ne resplendissais de rien du tout. Et puis je me demandais si Bach en avait écrit ne serait-ce qu’une seule, de chanson. A mon avis, il doit être facile de trouver des paroles, une fois que l’on a composé la musique. Et puis qu’est-ce que ça change, en fin de compte ?
« Si, il aurait pu », s’esclaffa Ana.
A force de penser à moi, j’avais oublié ce dont nous parlions, alors je ne compris pas qui « aurait pu » quoi. Mais je me dis bon, d’accord. S’il « aurait pu », tant mieux pour lui. S’il n’avait pas pu, c’eût été bien pire. Voilà pourquoi notre petit monde n’arrête pas de s’agiter d’avant en arrière, parce qu’il en vient toujours des qui peuvent quelque chose.
Bref, je n’avais toujours pas de vélo. Je ne sais pas combien de gens elle avait arnaqués avant moi, mais lorsque je l’invitai à me suivre, elle accepta. Ce qui voulait dire que j’étais le premier.
Je fis semblant de savoir où nous allions. A ce moment-là, j’aurais vraiment voulu que nous soyons précédés d’un guide brandissant un drapeau, ou quelque autre signe distinctif. Mais ce n’était pas le cas. De plus, j’avais déjà appris ma leçon de la journée, c’est-à-dire que les envies se paient. Or je n’avais pas énormément d’argent.
Mon sens de l’orientation dans cette ville laissait à désirer, bien que j’y vivais déjà depuis longtemps. J’aime ne pas cartographier les villes mentalement, si on ne le fait pas, tout a des élans de première fois, et on ne sait jamais quelles surprises chaque coin de rue nous réserve.
Et une surprise nous attendait effectivement. Sur le bitume, au beau milieu du trottoir, gisait une boule noire. Je me dis que ce devait être un oiseau mort (je me dis aussi qu’il s’était probablement tué en tombant de son vol), ce qui constituerait un assez bon présage. En m’approchant je me rendis compte que ce n’était rien d’autre qu’un bout de journal froissé.
D’après le fait d’avoir voulu y voir plus qu’il n’y en avait, je déduisis que je m’étais à nouveau retrouvé dans ma disposition romantique. Je dois reconnaître que je voulais trouver un beau geste à faire, surprendre Ana, peut-être même accomplir quelque acte héroïque, terrasser l’oiseau noir (j’avais momentanément oublié qu’il était déjà mort), ou quelque chose comme ça.
Alors que j’élaborais mes divers plans mentaux (un plan d’action est essentiel à celui qui veut se sortir d’un puits), Ana me raconta la chose suivante : elle était sourde d’une oreille, elle ne me dit pas laquelle, ni ne le lui demandai-je. Elle façonnait des boutons et se méfiait des fermetures-éclair, car un bouton, c’est rond, ce qui est beau en soi, et un objet qui peut, sur un coup de tête, se scinder en deux, puis à nouveau s’unir est inévitablement suspect. Elle vivait de la location de choses et d’autres. Elle n’aimait pas le muguet. Si elle pouvait choisir où vivre, ce serait à l’âge de pierre.
N’allez pas croire que je suis resté silencieux pendant tout ce temps. Non, moi aussi j’ai dit pas mal de choses. Par exemple :
« Qu’y a-t-il de mal à vouloir fermer sa veste plus rapidement ? »
« C’est quoi, le muguet ? Bon, de toute façon on s’en fout, puisque tu n’aimes pas ça. »
« Lève les pieds plus haut, le trottoir est mal fait » (elle trébuchait sans cesse sur les dalles).
« L’âge de pierre, ce n’est pas un « où », c’est un « quand. »
« Aujourd’hui nous sommes aussi à l’âge de pierre, mais la plupart des pierres sont en plastique. »
Et puis je dus aussi lui donner un mouchoir, car elle était terriblement enrhumée. Je ne sais pas comment j’ai pu coucher avec elle, j’ai une sainte horreur des virus et bactéries en tout genre.
*
Dommage que j’aie passé autant de temps à penser à Ana. Les vols ne durent jamais bien longtemps, sauf s’ils sont en direction de l’Australie, mais ce n’était pas le cas du nôtre. Peut-être une autre fois.
Sylvie avait fait en sorte que son ventilateur envoie l’air frais tout droit sur ma nuque. J’aimais les petites attentions qu’elle avait à mon égard.
J’aimais aussi être avec Ana. J’avais fait une photo d’elle nue. Une seule. Nous en l’avions imprimée en beaucoup d’exemplaires et en avions entièrement tapissé tous les murs. Chez elle, et chez moi. Il m’avait semblé qu’Ana avait l’air différente sur chacune d’entre elles.
« C’est vrai », acquiesça-t-elle.
Ana ne pouvait pas passer une seule minute dans le calme. Elle bougeait, comme si elle voulait cacher le fait qu’en vérité il ne se passait absolument rien à ce moment précis. Tous les matins Ana sortait louer ses vélos. Elle gagnait bien, assez pour elle, et pour moi.
Je ne voulais pas le raconter, mais tant pis. Ana s’est suicidée. Je l’ai tout simplement retrouvée morte un soir en rentrant. Elle avait avalé tous mes cachets, je ne sais pas comment elle avait fait pour en caser autant dans son estomac. Les médecins n’ont jamais réussi à déterminer lesquels des médicaments avaient causé son décès. A mon avis, c’était la lotion anti-poux. J’en avais acheté, juste aux cas où.
Ana m’avait laissé une lettre d’adieu. Ou plutôt une note qu’une lettre, mais elle était écrite sur une feuille de papier à lettres, alors je n’arrive pas à me décider comment l’appeler. Elle disait simplement : « Maintenant tu peux reprendre mon business. » Et rien d’autre. En bas, à gauche de la feuille il y avait le dessin d’un petit insecte. Cela ne fit que renforcer ma suspicion de la lotion anti-poux.
Je ne sais pas si la lettre m’était destinée, étant donné que mon nom n’y figurait pas. Mais il n’y avait non plus le nom de personne d’autre, alors c’est moi qui l’ai gardée.
J’ai essayé de reprendre son business, mais ça ne me réussissait pas. Dès la toute première fois un connard m’a éclaboussé de son café. Il me l’a tout simplement lancé à la figure. J’ai arrêté le business, mais je ne m’en faisais pas le moins du monde – j’allais fier, comme un rat d’égout. C’est tellement citadin, pensais-je en marchant. On ne se fait jamais arroser de café ailleurs qu’en ville. En plus, j’avais toujours l’argent que le connard en question m’avait payé pour le vélo. Moi, à sa place, j’aurais exigé à être remboursé non seulement pour la location, mais aussi pour mon café. Mais le connard n’était pas allé aussi loin dans sa réflexion. Alors je marchais et je souriais. Je souris aussi maintenant, en y repensant, et la femme de mes rêves est assise à ma gauche, en train de lire.
*
Sylvie ferma son livre. Elle le fit claquer plus fort que nécessaire. Peut-être m’étais-je assoupi, et voulait-elle me réveiller. L’hôtesse vint nous demander si quelque chose nous ferait plaisir. Je me fis la réflexion que ce qui me ferait plaisir, ce serait de l’embrasser, mais je ne dis rien. Si une femme me plaît, ce n’est jamais elle que j’ai envie d’embrasser, mais n’importe quelle autre.
Le pilote annonça que nous allions bientôt atterrir. Evidemment, il ne dit pas « bientôt », il fut très précis, mais je ne le compris pas, car au même moment Sylvie me demanda en quoi un cercle est meilleur qu’un carré. Je ne compris pas la question, alors je ne répondis rien. Je n’aime pas quand on attend de moi une réponse sans avoir posé de question claire. Alors elle me demanda pourquoi j’aimerais vivre dans un château de billes. Là, c’était plus clair, donc je lui dis qu’un carré, c’est exactement la même chose qu’un cercle, mais avec quatre angles.
Sylvie éclata de rire. Son rire était plaisant, même si l’une de ses dents était de travers. Cela me fit penser à mon premier amour. Il ne s’agissait pas vraiment d’amour ni de quoi que ce soit qui y ressemble, mais les gens ont tendance à targuer d’amour n’importe quelle relation proche. Moi, je qualifierais cela plutôt d’une forme d’indifférence avancée, une indifférence si forte que l’on en vient même à avoir envie de la montrer.
Mon premier amour habitait l’immeuble voisin. Nous avions tous les deux environ treize ans. Son nom était si laid que même maintenant le prononcer me serait trop déplaisant. Mauvais signe – il était clair d’emblée qu’il n’y aurait jamais rien de bon entre nous. Mais j’y allai quand même, crachant contre le vent tant qu’il me restait encore de la salive.
Elle était bien plus grande que moi, mais cela ne me dérangeait nullement. Elle me forçait souvent à l’embrasser. Et tant mieux, parce qu’à l’époque j’étais tellement nul que je n’aurais jamais osé le faire de mon propre chef. Avec elle je me sentais comme un chien au bout d’une laisse, qui doit chier non pas là où il veut, mais là où son maître daigne s’arrêter.
Elle en voulait plus que moi, alors elle m’effrayait. Je ferme toujours les yeux quand j’ai peur. Malheureusement, le plus souvent ça n’aide pas. Ça ne m’aidait pas à l’époque non plus. Elle me demandait toujours si je la trouvais si laide que je ne pouvais même pas la regarder. Le pire, c’est qu’elle était effectivement très laide. Donc je n’avais aucun moyen de répondre à sa question. J’ai dû me taire trop longtemps et trop souvent, car au bout de quelques fois elle me quitta.
J’ai déjà dit que je lui étais indifférent, mais je fus pris de la curiosité de savoir ce qui serait advenu si nous avions fini par rester ensemble. Lorsque je m’intéresse à quelque chose, le reste du monde cesse d’exister. Je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois.
Je me mis à la suivre partout (quand ma paresse ne prenait pas le dessus). Parfois elle se retournait et me disait :
« Qu’est-ce que tu veux ? »
Le ton sur lequel elle posait sa question changeait à chaque fois. Tantôt elle riait, tantôt elle beuglait, tantôt elle arrivait à peine à articuler quelques mots, et il me semblait qu’elle était sur le point d’en crever là, à mes pieds, juste après les avoir prononcés. A chaque fois je me disais tant mieux que je l’aie quittée, inconsistante comme elle est, parce que je ne supportais pas l’inconsistance sous quelque forme que ce soit.
On ne sait jamais quoi espérer de ce genre de personne. Par exemple, parfois elle s’arrêtait sans prévenir. Qu’est-ce que j’y pouvais ? Evidemment, je me heurtais à elle. Et puis elle m’accusait de harcèlement. C’était de sa faute. Moi, je n’ai jamais franchi la limite de la décence.
Et d’ailleurs, j’ai fini par ne jamais répondre à sa question. Qu’est-ce que je pouvais bien lui vouloir, dites-le moi ? Elle, qui baladait sa maigreur maladive en lançant sans arrêt des regards de gauche à droite pour voir si je n’étais pas en train de la suivre. Qu’est-ce qu’elle me voulait ? Qu’elle trace son chemin, mais non, il fallait qu’elle se retourne constamment. Elle ne devait pas vraiment savoir où elle allait elle-même, si elle perdait autant de temps à ce genre de futilités.
Mais un jour notre histoire toucha à sa fin. Sa mère m’arrêta dans la rue et me dit que si je ne laissais pas sa fille tranquille (j’essayai encore de lui dire que c’était elle qui ne me laissait pas tranquille, mais personne ne m’écoutait), donc, que si je ne laissais pas sa fille tranquille, j’aurais affaire à elle (c.à.d. à la mère). J’eus peur et je m’enfuis. Ensuite je le regrettai, mais à l’époque la perspective d’un acte sexuel – car quelle autre affaire peut-il bien y avoir entre un homme et une femme – avec une femme de vingt ans mon aînée m’effrayait encore plus que des baisers avec une fille de treize ans.
L’une des dents de la mère était de travers, je l’ai très nettement remarqué lorsqu’elle me faisait son discours sur les affaires. A cause de cette dent, dans ma tête elles étaient liées – Sylvie et cette mère – comme par une corde, comme le sont deux choses qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Je pense qu’elles devraient toutes les deux m’en être reconnaissantes, car en vérité elles n’avaient rien en commun. La perception des objets ne se limite pas à une addition d’éléments sensoriels, mais dans ma tête une connexion s’établissant entre deux éléments sensoriels crée une toute nouvelle configuration. La totalité des éléments devient alors bien plus que leur simple somme.
A l’époque je fumais énormément. Je fumais, je fumais, et rien, je n’en tirais rien du tout.
Vous vous posez sans doute la question logique de savoir si c’est avec cette pécore que j’ai perdu mon innocence. Cette question est tout à fait légitime. Et parfois je m’attends à une certaine suite d’événements, et parfois j’ai l’impression que certains événements devraient naturellement en découler d’autres de par la relation causale existant entre eux, sous réserve de conditions favorables. Non. Je n’ai pas perdu mon innocence avec elle. Et ce ne fut pas à cause de conditions qui auraient joué en ma défaveur. Je n’ai jamais perdu mon innocence. Je suis né coupable, du péché originel. J’ai lu dans la Bible que nous naissons tous avec un péché originel (j’y crois dur comme fer, bien que je ne croie pas un mot du reste de ce qui est écrit dans la Bible), alors après nous n’avons plus rien à perdre. Une théorie réconfortante. J’en connais d’autres comme ça, ce sont elles qui me guident. Je ne rencontre que peu de choses réconfortantes dans ma vie, alors je me contente de théories. Nous cherchons tous du réconfort, et voilà, j’en ai trouvé, moi.
*
J’ai toujours été néant, comme tout le monde. Mais contrairement aux autres, je n’ai pas cessé de le ressentir une seule seconde. Je ne suis jamais parvenu par aucun moyen à m’en persuader autrement. Parfois je me disais que si je regardais un miroir, mon reflet n’y serait pas. Je menais une vie silencieuse et vide, sans laisser aucune trace. Que demander de plus ?
Bien sûr, je tombais parfois tout comme vous dans quelque illusion de sens et de signification de ma personne. Ensuite j’en riais longtemps. C’est pour ça que je plaisais aux femmes. Elles appréciaient mon sens de l’humour. Je n’étais pas tout à fait de leur avis. Ou alors peut-être que je ne comprends tout simplement pas ce que c’est que l’humour.
Les femmes apprécient les hommes qui ont la faculté de ressentir. N’importe quoi, même si ce qu’ils ressentent c’est une inflammation dentaire. Au moins ça. J’ai entendu l’une d’entre elles comparer la douleur à une goutte d’encre.
- De l’encre ? N’importe quoi —, lui dis-je, sans doute trop sèchement, mais je détestais les banalités.
Elle m’expliqua que lorsque l’on fait tomber une goutte d’encre dans un verre d’eau, celle-ci s’y répand peu à peu, tout comme la douleur, et y forme d’assez jolis motifs jusqu’à ce que toute l’eau soit teintée de bleu. Nous avons décidé d’essayer, pour mettre sa théorie à l’épreuve. La seule encre que nous avions était marron, alors évidemment ce n’est pas de bleu que l’eau s’est teintée. Je trouve que cela infirme complétement son hypothèse. Je ne parvenais à établir absolument aucune association entre la douleur et un verre d’eau brunâtre.
Cela devait sans doute se lire très nettement dans l’expression de mon visage. (Avec le recul, je pense que j’aurais dû éviter de sourire de la sorte : bon, une théorie infirmée de plus, et alors ?) Elle fondit alors en larmes et me demanda encore si j’étais vraiment con ou si je faisais exprès. Je lui dis que je faisais exprès (il me semblait que cela la consolerait, mais j’avais tort). Je lui dis alors que c’était la première fois que je voyais quelqu’un pleurer autant pour une simple théorie infirmée. Comme elle ne répondait rien, je précisai que je n’avais d’ailleurs jamais vu personne pleurer pour une théorie tout court, ni vraie ni fausse.
Je ne me souviens plus très nettement de ce qui s’est passé ensuite, mais il me semble qu’elle m’a jeté quelque chose. Quelque chose qu’elle tenait en main. Elle m’a eu, mais j’étais trop mou (les femmes aussi me disent souvent que je suis trop mou), alors ce « quelque chose » se brisa en tombant au sol. Il m’était tout à fait impossible de déterminer la nature de l’objet d’après les éclats. Elle pleurait encore plus fort, quoiqu’il me semblât que là c’était moi celui qui devait pleurer.
C’est à cause de connards comme toi que le monde va finir, — criait ma petite-amie (qui n’était pas du tout ma petite-amie, mais je ne sais pas comment l’appeler autrement).
Quant à cette théorie-là, elle me plaisait. J’avais toujours cru que c’étaient les gens intelligents qui étaient à l’origine de tout événement, et non pas les débiles et les couilles-molles de mon espèce. Ce sont eux, les forts, qui créent et qui détruisent, après avoir tout bien soupesé. Or elle, elle était apparemment de l’avis contraire. J’aurais bien voulu qu’elle m’en parle plus en détail, qu’elle m’explique pourquoi elle raisonne ainsi, mais mon intuition me disait que sa théorie serait tout à fait infondée, qu’elle ne trouverait pas d’arguments convenables pour l’étayer. Je ne voulais pas me sentir déçu d’elle, alors je ne lui demandai rien.
Pendant qu’elle pleurait en silence, j’eus encore le temps de me dire que la fin du monde, ce n’était en fin de compte peut-être pas si mal, qu’ensuite tout ne pourrait aller qu’en s’améliorant. Et d’ailleurs, pourquoi serait-ce nécessairement pire ? Je n’eus pas le temps d’aller au bout de cette idée, il fallait que j’aille lui essuyer ses larmes. J’avais vu des hommes faire cela dans des films, alors je faisais pareil. J’imite toujours ce que je vois, ou je fais ce qu’on me dit de faire. Où est le mal ? Qu’est-ce qui me dit que je trouverais quelque chose de mieux à faire ?
Je lui essuyai donc ses putains de larmes, au début elle résista un peu (elle avait sans doute aussi dû voir des femmes se comporter ainsi dans quelque film). Ensuite elle s’est calmée, nous avons fait l’amour, ce n’était pas trop mal, enfin il ne s’est rien passé d’autre avec elle qui vaille la peine d’être raconté.
*
Ainsi mes pensées vaquaient, mais moi-même je restais immobile. J’étais assis dans un avion avec Sylvie, or les avions n’offrent pas vraiment de grande liberté de mouvement. Sylvie ne lisait plus son livre, elle était assise calmement, les bras croisés, et elle attendait. Elle ne regardait même pas par le hublot. Elle avait tort, car nous allions atterrir et il n’y avait que de l’eau à perte de vue. Je me penchai vers le hublot pour mieux voir. Or vers le hublot, c’était aussi vers Sylvie. Je me disais qu’au cas où cela lui déplairait, le hublot constituerait une bonne excuse. Mais elle aimait ça (je l’ai déduit du fait qu’elle ne disait rien).
Je me penchai encore plus. Je fais toujours cela : si j’entame quelque chose, je veux savoir ce qui se produira si je continue. C’est agaçant, même pour moi. Lorsque je m’étais penché assez pour finir complétement étendu sur Sylvie, je dus mettre un terme à mon expérience, car mon front était déjà contre le hublot, et je n’avais toujours récolté aucune réaction. Sylvie restait assise comme si de rien n’était. Moi aussi je restais assis, avec mon front contre le hublot. Je ne pouvais pas me redresser sans raison, je ne voulais pas passer pour un demeuré. Le score frôlait les « 2 : 1 » pour elle.
Nous avons gardé cette position jusqu’à l’atterrissage. Evidemment, au moment de toucher le sol mon front percuta le hublot.
- Tu veux un bisou magique ? — plaisanta Sylvie.
- Je m’en ferai un moi-même, — rétorquai-je, lui provoquant un éclat de rire encore plus intense. Même si le fait de me redresser était à présent justifié, le score se rapprochait inexorablement de « 2 : 1 ».
Nous sommes descendus de l’avion en discutant de choses et d’autres, comme de vieux amis. Ma nouvelle position géographique m’apportait un certain réconfort. J’aurai toujours une excuse pour m’éclipser au besoin.
Il s’est avéré (ces choses-là s’avèrent toujours) que nos hôtels se trouvaient dans des rues voisines, et ni elle ni moi n’avions rien d’autre à faire ce soir-là, à part arpenter de long en large cette ville que chacun d’entre nous avait apparemment déjà visité une centaine de fois auparavant (ça aussi, ça finit toujours par s’avérer).
Comme de vieux amis, nous avons pris le même taxi, d’abord jusqu’à son hôtel : c’est là que je l’ai laissée. Nous nous y sommes arrêtés assez longtemps, plus longtemps qu’il ne lui aurait fallu pour sortir sa valise. La raison en était très simple : c’était la première fois que je voyais une femme-portier. Elle était anormalement belle. Sur son insigne il était écrit : « Aube ». Je ne sais pas pourquoi, sans doute travaillait-elle jusqu’à l’aube. J’aurais voulu savoir ce qu’elle faisait après.
Sylvie et moi avons bavardé encore un moment. Je ne sais pas comment je m’y suis pris, car d’habitude je n’aime pas bavarder. Nous avons fixé un rendez-vous (il ne s’est avéré que plus tard que nous ne l’avions pas très bien organisé. Merci au portier), et je suis parti vers mon hôtel.
Vous n’y croirez pas, mais j’ai mis énormément de soin à me préparer. J’ai essayé ci, j’ai essayé ça, puis finalement ça s’est fini comme d’habitude : j’ai enfilé un jean et un T-shirt gris avec écrit : « Que peux-tu contre un somnambule qui est plus intelligent que toi, qui écoute attentivement tes arguments, puis se replonge dans son somnambulisme ? » Les lettres étaient petites, gris foncé. Je ne me souviens plus de la provenance de ce T-shirt, et je ne sais pas qui était le génie qui avait eu l’idée d’écrire cette phrase dessus. Malgré ces incertitudes, le T-shirt me plaisait. C’est pourquoi je l’ai enfilé. Quitte à se faire beau, autant ne pas y aller à moitié.
En chemin je suis encore passé chez le coiffeur. Je vais toujours chez le coiffeur lorsque je suis dans cette ville. Je ne voulais pas que cette fois-ci devienne exceptionnelle dès le tout début. Ce fut une erreur, car il m’a fait une coupe de connard, et en plus il m’a tartiné de gel. J’ai dû faire un détour par les toilettes de la gare pour me laver les cheveux. C’était difficile, l’évier était très bas et le robinet en était si proche que je n’arrivais pas bien à mettre ma tête entre les deux. Je me suis complétement mouillé le dos en me dandinant de la sorte. J’ai dû sécher mon T-shirt avec le sèche-mains. Ça me prit assez longtemps, me mettant presqu’en retard.
Le sèche-mains faisait beaucoup de bruit, mais peu de chaleur. Mon T-shirt n’avait absolument pas séché, alors j’avais froid.
« Oh, allons t’acheter de quoi te couvrir », se réjouit Sylvie. Ou peut-être se réjouissait-elle du fait que nous ayons enfin réussi à nous retrouver. Car ça n’avait pas été facile. Nous avions convenu de nous rencontrer au coin de la place. Evidemment, en arrivant je ne l’y trouvai pas. Bien que la place fût parfaitement carrée, j’ai longtemps tourné en rond avant de tomber sur elle.
Je ne sais pas combien de temps j’ai traîné sur cette place, je commençais déjà à craindre que Sylvie ne m’y attende pas. Mais elle m’attendait, et dès qu’elle me vit elle dit : « Oh, allons t’acheter de quoi te couvrir ».
Je ne vois aucun mal à ce qu’une femme veuille m’acheter quelque chose, alors j’ai accepté avec plaisir. Sylvie était une vraie pro du shopping. Elle a choisi tout un tas de blazers pour moi. Ça m’a un peu vexé. Elle trouvait sans doute mes épaules trop étroites et devait vouloir les cacher. Mais j’ai fait comme si de rien n’était. De toute façon les blazers, le plus souvent c’est gris.
Sylvie s’est introduite dans la cabine d’essayage avec moi dès le tout début.
« Je veux voir lequel te va le mieux », expliqua-t-elle.
Eh bien qu’elle regarde, puisque c’est ce qu’elle veut. Mais elle n’a pas fait que regarder. Elle m’aidait à m’habiller, à me déshabiller, elle ajustait mes vêtements (si soigneusement, comme si c’était moi qu’elle ajustait). Je suis resté bouche bée tout le long. Elle me touchait beaucoup, mais ça ne m’excitait pas le moins du monde. Je ne faisais qu’essayer des blazers, c’est tout. Chacun d’entre eux m’allait comme un gant. Je me dis que si on est bel homme, on peut porter n’importe quoi. Au moins une situation où je ne suis pas difficile.
Elle se mit en tête d’en acheter un vert. Vert ce n’est pas gris, mais j’acquiesçai quand même.
« Et on voit ton Orwell », dit Sylvie.
J’ai pensé qu’elle parlait de mon pénis, qui avait tout de même enflé depuis notre entrée dans la cabine. Plus je le regardais, plus il enflait. A présent Sylvie aussi s’en était rendue compte, ça semblait lui plaire, elle rit, elle passa la main dessus. Elle se tenait juste à côté de moi, j’aurais pu lui faire tout ce que je voulais. Et n’allez pas croire que je n’en avais pas envie, je ne savais tout simplement pas comment m’y prendre dans une cabine d’essayage. Je touchai les cheveux de Sylvie. Elle était bien plus petite que moi. Je voyais très nettement la raie de ses cheveux, qui étaient crépus, ce qui m’excitait encore davantage. Sylvie continuait de caresser mon pénis. Je m’appuyai contre le mur. Sylvie recula un peu et s’appuya contre le mur opposé. Nous continuions à nous regarder ainsi, sans savoir quoi faire à présent. Sans doute aurais-je dû, en tant qu’homme, prendre l’initiative, mais rien de bien ne me venait à l’esprit, alors je dis :
« 2 : 1 pour toi ».
Ça détendit l’atmosphère.
« Allons-nous-en », proposa Sylvie. « Ou as-tu peur qu’on aperçoive ton Orwell ?
Sylvie riait, moi je ne comprenais pas ce qu’il y avait de drôle. A quoi s’attendait-elle en me suivant dans la cabine ?
« Le mien aussi serait visible, s’il n’était pas à l’intérieur », dit Sylvie.
Je n’avais encore jamais entendu une femme parler comme ça. Et des femmes, croyez-moi, j’en ai eu assez pour pouvoir tirer certaines conclusions.
Alors que nous nous apprêtions déjà à sortir du magasin, Sylvie me dit :
« Je voulais juste dire que quand tu mets un blaser, on aperçoit la citation sur ton T-shirt. C’est d’Orwell. Tu ne savais pas ?
La question n’était pas tout à fait claire. Je ne comprenais pas si Sylvie voulait me demander si je ne savais pas ce qu’elle voulait dire en parlant d’Orwell, ou si je ne savais pas que la citation était d’Orwell.
Sylvie n’y attachait visiblement pas d’importance particulière, car elle n’attendit pas de réponse et dit à brûle-pourpoint :
« Dans une telle situation, n’importe qui de normalement constitué voudrait aller boire un coup. »
Dieu merci, je suis quelqu’un de normalement constitué. Ou du moins j’aspire à le devenir. Sinon je pourrais créer quelque chose qui n’a encore jamais existé. A quoi bon ?
Le blazer me procurait une chaleur assez agréable, j’ai fini par ne même plus l’enlever, la vendeuse en a simplement coupé les étiquettes aux ciseaux sur moi. Evidemment, à ce moment-là Sylvie dit fort (clairement parce qu’elle visait le « 3 : 1 ») :
« Finalement ce blazer couvre quand même Orwell », elle riait et regardait mon pénis.
La vendeuse faisait mine de ne rien comprendre. C’est son travail. Visiblement elle en avait vu d’autres, une simple trique ne l’impressionnait plus. Moi non plus, ça ne m’impressionnait pas, alors il n’y eut pas de « 3 : 1 ».
[*] Bhagavad Gītā, textes 13-14